Personne en France, depuis les années 1970, n’avait réussi avec autant de succès que le Comité invisible (CI) l’entreprise de rendre public un discours se réclamant d’une politique révolutionnaire. Alors que la quasi-totalité de la gauche de la gauche a fait son deuil du mouvement ouvrier, comme celui d’une politique révolutionnaire qui, n’ayant plus de sujet, n’a plus de raison d’être, le CI semble au contraire se resaissir positivement de cette absence. Il en fait le fond d’un projet révolutionnaire renouvelé.
Depuis l’Insurrection qui vient (2007), 7 années de crise se sont écoulées, au cours desquelles des insurrections ont effectivement éclaté : en Grèce, dans le monde arabe, mais aussi en Turquie, en Espagne, aux Eredactreretats-Unis, en Suède, en Bosnie, etc. A nos amis part d’un constat : ces insurrections, restées étouffées au stade de l’émeute ou trahies, ont échoué a opérer une transformation radicale du monde. Le CI met d’emblée cet échec sur le compte du manque d’organisation des révolutionnaires, conçu comme le manque d’une commune perception du monde. “Ce qui fait défaut à la situation, ce n’est pas la bonne volonté des militants ni la diffusion de la conscience critique, ni même la multiplication du geste anarchiste. Ce qui nous manque, c’est une perception partagée de la situation.” Face à un monde qui reste “globalement inintelligible”, il faut développer “l’intelligence stratégique du présent”. Il faut créer “un langage à même de dire à la fois la condition qui nous est faite et le possible qui la fissure”, ce qui est la condition de possibilité d’un mouvement révolutionnaire victorieux. Cette perception commune est ce que le texte se propose d’élaborer.
Il nous faut signaler ici une difficulté qui a trait au type d’énonciation du texte. C’est que l’élaboration de cette perception commune, censée permettre aux mouvements de se féderer et à la Révolution de triompher, se fait selon des modalités discursives singulières. C’est ce qu’une première lecture rend manifeste : il s’agit moins d’argumenter que de révéler. Le ton même du texte, assertif et tranchant, n’est pas celui de l’argumentation théorique, mais celui du pamphlet. Ce discours se présente comme l’émanation évidente du “mieux penser”, du “vrai”. Cette vérité se donne de manière immédiate, comme substitution de bonnes opinions aux mauvaises opinions. Une substitution arbitraire dont le texte est à la fois l’instigateur, le bénéficiaire et le juge. Il ne fait appel à rien d’autre pour démontrer ce qu’il affirme que son propre jugement. L’objectivité auquel se réfère le texte n’est jamais pour lui une contrainte, en ce qu’elle n’est jamais à penser. L’évocation des luttes, par exemple, est toujours opérée sur un mode anecdotique. On note la présence de tel slogan sur un mur ou le plaisir d’être ensemble des insurgés à telle occupation, au même titre qu’on note leur échec. Le discours tient la légitimité de son énoncé de l’être révolutionnaire postulé de ses auteurs. A nos amis est donc d’abord un texte normatif.
Ainsi, il nous semble vain de discuter de la pertinence ou non du projet politique du CI tel qu’il se présente. La force même de la norme est de ne laisser de place qu’à l’adhésion ou au désaccord, comme le signale peut-être d’emblée le titre de l’ouvrage. Nous ne discuterons donc pas, par exemple, de la question “stratégique” de savoir s’il faut bloquer ou occuper. Il nous semble plus fondamental de comprendre pourquoi et comment le concept de stratégie est ici mis en jeu, de comprendre quelle est sa fonction normative. Plus généralement, nous ne jugerons pas le texte sur la base du projet qu’il nous livre explicitement. Le fait que cette perception commune ne soit qu’un ensemble de mots d’ordres et d’injonctions appellant à une complicité qu’on n’a d’autre choix que d’accepter ou refuser le rend, tel quel, imperméable à une critique rationelle. Nous pensons par ailleurs qu’il serait naïf de critiquer l’arbitraire du texte comme une marque d’indigence théorique, de lui reprocher les erreurs ou les faiblesses d’analyse auquel il donne lieu. Un rapide coup d’œil sur les textes antérieurs de la revue Tiqqun nous laisse plutôt penser que les textes du Comité invisible ne sont que l’aspect exotérique d’une conceptualisation plus poussée dont ils héritent. Cela ne nous mènera pas à conduire une analyse comparée de Tiqqun et d’A nos Amis, nous en tirerons simplement la conclusion que tout ce qui est posé dans le texte est posé à dessein. Qu’il n’y a pas d’errements, de théorie qui se cherche, mais qu’il y a un discours déjà construit qui s’exprime selon des modalités choisies. Que, contrairement à ce que déclarent les auteurs, “un poème, une chanson” n’aurait pas suffi.
Parce que l’analyse d’un texte normatif rend nécessaire l’identification des normes qui le structurent et la critique de ces normes en tant que telles, nous essaierons d’identifier la rationalité propre du texte, le geste qui lui permet de poser ses conditions d’énonciation. Nous chercherons à identifier sa mécanique, à déceler ses actes de légitimation, à identifier ses outils propres pour enfin le ramener sur un terrain où il peut être évalué rationnellement. Nous verrons que le geste principal du texte consiste à saper l’objectivité du monde pour montrer sa contingence, que ce geste a pour but de donner toute sa place à une identité conçue comme seule positivité. Il conviendra alors de montrer ce qu’est réellement cette identité en la dégageant des normes qu’elle édicte.
DEFAIRE L’OBJECTIVITÉ
« Tout ce qui est, est bon. (…) Le mal n’est pas une substance, s’il était une substance, il serait bon. Le mystère de l’effectivité du mal se résout en ceci que le mal n’est pas, mais qu’il est un néant actif. » (Tiqqun n°1, éditorial, Eh bien, la guerre !)
Le geste fondamental du texte est de défaire l’objectivité du monde social. Le déterminisme des classes, de l’économie, de l’Histoire est rejeté du côté de l’idéologie. Y est substitué la révélation de la “vraie” nature du monde, qui a toujours pour fonction de dévoiler la contingence de l’ennemi, et par là sa faiblesse. Pour fixer des normes, il convient de dénier toute réalité a des portions du réel qui pourraient entrer en concurrence avec ces normes.
La composition du monde social
En ce sens, une bonne partie du texte consiste à remettre en cause l’effectivité du social.
“Il nous faut nous débarrasser de tous le fatras mental qui fait obstacle à la claire saisie de notre commune situation, de notre “commune terrestritude”, annonce le texte dans son introduction. Il est donc clairement formulé que les oppositions existantes dans le monde social ne sont que des apparences faisant obstacle à une unité qui est, elle, essentielle et réelle, et qu’il importe de mettre en avant afin de la rendre effective. Cette “commune situation” n’est jamais rigoureusement définie, mais on sent bien qu’elle désigne une commune souffrance, une commune insatisfaction (« La manifestation du capitalisme dans nos vies, c’est la tristesse », disait l’Appel).
Tout le monde, cependant, n’a pas conscience de cette commune situation. C’est précisément ce qui permet de regouper les individus en catégories. Les différences entre les individus ne sont plus des différences objectives mais subjectives, situées sur le plan d’un rapport au monde. Le texte déploie dès lors une typologie des individus qui substitue à des différences sociales conflictuelles l’idée d’une hiérarchie de conscience. Les individus sont classés selon qu’ils sont plus ou moins soumis au monde, à son illusion. En bas de l’échelle, il y a le Bloom, l’“employé pavillonnaire”, le “salary man” qui constitue la population “apathique et apolitique”. Il s’agit en somme de la classe moyenne, de la portion intégrée des travailleurs, des consommateurs. Qualifiés de véritables “walking-dead”, ils incarnent l’apocalypse déjà présente, le résultat d’une civilisation occidentale à l’agonie. En haut de l’échelle, il y a le “Nous”, “nous autre révolutionnaires”, des “insurgés” grecs aux indigènes d’Amérique du Sud en lutte. Les révolutionnaires s’assimilent au peuple, entité politique, constituée de n’importe qui prend son parti. Le révolutionnaire s’oppose en tous points au Bloom : il est actif, celui-ci est passif, il est du côté de la joie, celui-ci est soumis à la tristesse, il est hors du monde, celui-ci y est asservi. Entre la population et le peuple, la catégorie de ceux qui se trompent et que le texte a pour mission d’éclairer, la “gauche”, socialistes et marxistes confondus, à laquelle il est centralement reproché son impuissance (socialistes) et sa soumission aux catégories du monde, notamment à l’économie (marxistes).
Ce qui est nié, c’est que cette condition de métropolitain (le “métro-boulot-dodo”, comme on disait en 1968), qui est le summum de l’aliénation pour le CI, soit considérée comme souhaitable par beaucoup, auxquels elle est refusée – l’accès à un logement, à un emploi stable notamment, et également qu’elle implique l’existence de ces derniers comme exploités. Tant qu’il y aura des banlieues pavillonnaires et des résidences de luxe, ceux qui les construisent ne pourront pas les habiter. C’est moins l’inégalité des conditions objectives qui disparaît dans cette topologie que leur nécessaire intrication. Dire qu’il n’y a pas de différence matérielle de situation c’est surtout déconstruire l’idée de rapports sociaux. L’exploitation ne saurait dans ce cadre être analysée que comme conséquence fortuite d’un “monde” qui de toute façon est mauvais. Lui conférer un statut déterminant c’est tomber sous le coup d’une idéologie, idéologie dont la fonction est précisément d’empêcher la claire saisie de cette commune situation. La lutte des classes est une illusion.
Les inégalités existent donc, en premier lieu, dans la conscience, ce qui n’est plus un problème dès lors que le texte se propose d’éclairer chacun sur la communauté de situation et donc de combat qui nous lie. Il suffisait de le faire.
Malgré ce geste, des inégalités existent et sont empiriquement constatable, y compris pour le CI, qui règle le problème en changeant de terrain. Le fait qu’il y ait des riches et des pauvres ne doit pas être envisagé comme un problème social, il est imputé à la seule existence du “pouvoir”. C’est ce que la redéfinition du capitalisme rend manifeste. “Le capital ne se pose plus la question de la société”, “toute prétention totalisante a été abandonnée”(184). C’est-à-dire que le capitalisme n’est pas conçu comme une totalité sociale faite d’interactions complexes socialement polarisées. Il est la pure existence matérielle d’un phénomène anomique.
Ainsi, s’étant montré incapable de faire société ou y ayant renoncé (la seule raison qui est donnée à ce phénomène serait que dans les luttes des années 60/70 on lui aurait dit qu’on ne voulait plus de lui, ce qu’il aurait pris au mot) le capitalisme aurait substitué à la vieille mécanique de l’”intégration” (donc de la société) celle de la “sélection”. Une sélection qui consiste à trier entre ses élus et les autres, dont il n’a pas besoin, et qui sont rejetés comme surnuméraires dans un en-dehors qui n’est pas réellement défini. S’il y a “partition entre territoires productifs d’un côté et sinistrés de l’autre, entre la classe smart d’une part et de l’autre les idiots, les attardés, les incompétents”, cette partition “n’est plus prédéterminée par une quelconque organisation sociale ou tradition culturelle” (184). Il est à noter que rien dans le texte ne remplit ce vide et la question reste entière de savoir ce qui détermine alors cette partition. L’explication proposée de l’existence concrète de l’opposition entre riches et pauvres, c’est donc tout d’abord une sorte d’évidence, celle de la séparation spatiale, de la répartition géographique des populations en fonction de leur place dans le système capitaliste. Mais l’analyse ici n’ajoute rien à ce qu’elle décrit. Cette répartition s’effectue à la manière d’une opposition binaire, entre des “exclus” et des “élus”, que rien ne lie entre eux, puisqu’il s’agit d’une pure différenciation. Ainsi viennent s’opposer “les smart cities et les banlieues pourries” sans que soient analysées les causes de l’existence des unes et des autres, et ce qui dans l’existence des unes pourrait éventuellement être cause de l’existence des autres.
C’est qu’ici l’important est de montrer que cette sélection s’opère du dehors, qu’elle est extérieure aux individus qui la subissent, et que donc le “pouvoir” lui-même est extérieur aux individus, qu’il n’est pas incarné.
C’est ce que vient confirmer l’analyse du pouvoir comme étant la seule existence des infrastructures, “sous la forme d’une ligne haute tension, d’une autoroute, d’un sens giratoire, d’un supermarché ou d’un programme informatique (…) le pouvoir c’est l’organisation même de ce monde” il est “désormais immanent à la vie telle qu’elle est organisée technologiquement et mercantilistement. Il a l’apparence neutre de l’équipement ou de la page blanche de Google” (84). Les analyses du CI rejoignent là le vieux fond situationniste dont elles sont issues, avec la critique de l’urbanisme et de la cybernétique. « L’urbanisme est cette prise de possession de l’environnement naturel et humain par le capitalisme qui, se développant logiquement en domination absolue, peut et doit maintenant refaire la totalité de l’espace comme son propre décor. » (G. Debord, La Société du spectacle)
Le terme de « décor » employé par Debord suggérait déjà la facticité de l’espace produit par l’urbanisme, et si ce décor était déjà celui d’un pouvoir, ce pouvoir était nommé, c’était « la domination absolue du capital ». Le Comité invisible va plus loin, car pour lui le décor est le pouvoir, c’est-à-dire que la domination des apparences est totale. C’est cela le « nihilisme » de ce monde, c’est son incarnation, son existence matérielle même, ou même la pure matérialité de son existence. Cette existence est apolitique et dépourvue de langage, « mutique ». Au bout du compte, les raisons d’exister de ce monde ne sont ni politiques (la domination d’une élite) ni économiques (l’exploitation), elles sont purement techniques. Le but de ce monde est de continuer, aveuglément, comme le Golem marche sans savoir où il va ; personne n’en bénéficie véritablement, et les « dominants » comme la police ne sont en réalité là que comme les agents d’entretien d’une machinerie dépourvue de sens, semblables en cela à ces ouvriers qui se contentent de surveiller la bonne marche des machines.
Une fois cela établi, il est évidemment vain et risible de chercher des raisons là où il n’y en a pas. Il faut débrancher ces machines, couper ces flux, laisser mourir le cadavre maintenu en état de mort cérébrale médicalement assistée qu’est le capitalisme, qu’est « ce monde ».
La conjoncture comme mensonge
Il découle de cette conception générale du capitalisme une analyse de la situation actuelle qui prolonge ce geste de désobjectivation.
Le CI s’attaque d’abord à la crise économique, qu’il redéfinit comme une pure technique de gouvernement. La baisse des salaires, la flexibilité croissante du travail, les faillites, les délocalisations et le chômage, les plans d’austérité et les tensions sociales et politiques qui en découlent ne sont qu’un écran de fumée qu’il faut dissiper. Le capital, loin de subir les crises “s’essaie désormais à les produire expérimentalement” (22) Elles sont son moyen de “restructurer” (on ne sait quoi, on ne sait pourquoi). Elles lui permettent de “susciter volontairement le chaos afin de rendre l’ordre plus désirable que la révolution.” parce que “maintenir la population dans une sorte d’état de choc permanent entretient la sidération, la déréliction à partir de quoi on fait de chacun et de tous à peu près ce qu’on veut.”
Si tel est le cas, on peut à juste titre se demander pourquoi le “capital”, “les Etats”, ou “ le gouvernement” (l’indistinction pose problème dans la mesure où si le bénéficiaire du “chaos” est le capital, les gouvernements en revanche sont durement malmenés, du simple point de vue électoral, et dans le cas où l’Etat serait le bénéficiaire, il faudrait déterminer ce qui le distingue des gouvernements, et du capital, etc.), pour se rendre plus désirables que la révolution, n’achètent pas tout simplement la paix sociale en redistribuant, comme ils en ont les moyens. Pourquoi cette nécessité du chaos quand l’ordre peut être immédiatement imposé ? On peut aussi se demander quel est son intérêt à maintenir la population dans un tel état. “La crise actuelle ne promet plus rien ; elle tend à libérer, au contraire, qui gouverne de toute contrainte quant aux moyens déployés.” En vue de quoi au juste ces moyens sont-ils déployés ? Que s’agit-il de faire, puisque l’exploitation du travail n’existe pas ? La seule réponse que le texte suggère est qu’il s’agit, par le renforcement d’un mensonge, d’empêcher l’avènement du vrai. D’empêcher que la population, cette masse de révolutionnaires en puissance, ne réalise qu’on lui ment. De l’empêcher de réaliser son être vrai.
En témoigne le développement sur l’austérité, qu’il convient de resituer sur son véritable terrain, “celui d’un brutal désaccord éthique”. Alors que la gauche voyait naïvement dans les plans d’austérité la tentative de relancer l’accumulation capitaliste en dévalorisant la force de travail, en augmentant le taux d’exploitation, l’austérité est décrite comme une certaine idée du bonheur. “Certains considèrent que l’austérité est, dans l’absolu, une bonne chose, tandis que les autres considèrent, sans vraiment oser le dire, que l’austérité est, dans l’absolu, une misère.” Les premiers se font une idée “protestante” du bonheur, qui consiste à “être travailleur, économe, sobre, honnête, diligent, tempérant, modeste, discret”. C’est cette idée qui s’imposerait partout et qui se cacherait derrière l’illusion des plans d’austérité. Se battre contre les plans d’austérité, c’est-à-dire refuser les coupes budgétaires, l’affaiblissement du système de santé, les baisses de salaire, etc., c’est être “assuré de perdre”. Non pas parce que l’Etat dispose de tous les moyens de la répression face aux mouvements sociaux, mais parce que c’est se tromper sur le véritable enjeu du conflit et par là commettre une erreur stratégique. “Ce qu’il faut opposer aux plans d’austérité, c’est une autre idée de la vie, qui consiste, par exemple, à partager plutôt qu’à économiser, à converser plutôt qu’à ne souffler mot, à se battre plutôt qu’à subir, à célébrer nos victoires plutôt qu’à s’en défendre, à entrer en contact plutôt qu’à rester sur sa réserve.” (51/52) Contre la répression, la convivialité ! Quand les fonctionnaires voient leurs salaires divisés par deux en Grèce, on peut se demander quelles ressources il leur reste à partager, et quelles victoires à célébrer.
On notera enfin la curieuse réintroduction des “gouvernants” dans cette partie, alors même qu’il avait été établi que le pouvoir n’était plus personnel, mais logistique, et que les gouvernants ont été qualifiés de “clowns” qui n’ont pour fonction que de “divertir”. Cela importe peu en fait. Il s’agit ici de montrer que la crise est un mensonge dont le but est de maintenir les gens dans l’illusion de la nécessité d’un gouvernement. Dire que la crise n’est pas économique, c’est la ramener sur le terrain contingent du “pouvoir”. Il n’y a pas d’autre nécessité à ce qui arrive que celle de nous maintenir dans un état de soumission à une force contingente.
Le développement sur la crise écologique reprend le même schéma. La peur de l’apocalypse, répandue par les films catastrophes (d’emblée tout ce qui a trait à une possible catastrophe n’est pris en compte que comme discours du pouvoir) assure la même fonction qu’assurait hier la “menace soviétique” : “faire en sorte que la population se tienne prête à se défendre, c’est-à-dire à défendre le système. (27). “Elle n’est énoncée que pour appeler les moyens de la conjurer, c’est-à-dire, le plus souvent, la nécessité du gouvernement (…) imposer ici et maintenant l’attente, la passivité, la soumission” (35).
La crise écologique, celle des dégâts occasionnés par un système qui postule comme condition de son existence l’accroissement de la production industrielle n’est pas pensée. Une fois encore, là n’est pas la question. “La véritable catastrophe est existentielle et métaphysique”. Ce qui est en jeu, c’est notre capacité à habiter le monde différemment, en se déprenant d’une conception occidentale de l’existence : “l’étrangeté au monde”. Ici aussi, il suffit de le faire.
“Tout ce que le réel contient d’instable, d’irréductible, de pesant, de chaleur et de fatigue, voilà ce dont il a réussi à se protéger en le projetant sur le plan idéal, visuel, distant, numérisé, sans friction ni larmes, sans mort ni odeur de l’Internet (…) ce n’est pas le monde qui est perdu, c’est nous qui avons perdu le monde et le perdons incessamment ; ce n’est pas lui qui va bientôt finir, c’est nous qui (…) refusons hallucinatoirement le contact vital avec le réel. La crise n’est pas économique, écologique ou politique, la crise est avant tout celle de la présence.”
Au regard de cette misère existentielle, les désastres effectifs deviennent l’occasion d’une “reprise en main euphorique” de nos vies : le tremblement de terre de Mexico en 85 est pris comme exemple d’une de ces brèches où les individus apprennent d’autres manières de vivre. “Les désastres effectifs offrent une issue à notre désastre quotidien.” Sous couvert de critiquer la vieille chimère de l’état de nature et son cortège d’exactions incontrôlables, c’est la misère effective des populations qui est niée.
Il n’y a pas de conjoncture. La situation présente n’est pas à proprement parler historique, elle n’est pas le produit de l’affrontement de forces réelles situées historiquement. Ce sont plutôt deux visions du monde qui s’opposent. Contre le mensonge et l’illusion, la puissance éthique. C’est ce qu’incarne la révolution.
La révolution comme nécessité éthique
Dès lors que les conditions de la révolution ne sont plus à chercher dans les rapports sociaux effectifs ni donc dans l’Histoire, il faut les chercher ailleurs. Ainsi, dès l’introduction, le seul motif aux soulèvements révolutionnaires récents est identifié comme “le besoin de changer le monde” (12), ce besoin revêtant le caractère d’une évidence ontologique. On pourrait évidemment se demander pourquoi, dans le cas Tunisien par exemple, ce besoin ne s’est pas manifesté pendant cinquante ans, et pourquoi il s’est exprimé dans le contexte d’une crise économique mondiale et plus particulièrement d’une hausse du cours du prix blé, hausse dont l’Algérie voisine a pu réguler les effets grâce à la manne pétrolière, ce qui l’a maintenue à l’abri des insurrections du Printemps arabe. Cela n’a naturellement rien à voir avec le fait que le peuple algérien aurait eu alors moins besoin de changer le monde que le peuple tunisien. On pourrait en revanche se poser des questions sur ce qui risque de se produire aujourd’hui en Algérie dans le contexte de la chute des cours du pétrole. Mais tout ceci donnerait lieu à de fastidieuses analyses dont l’objectivisme économique tomberait de toute façon à plat. On s’interrogerait vainement sur les origines objectives des insurrections, puisqu’elles n’en ont pas : leur seule source est le besoin qu’elles ont d’elles-mêmes, et ce besoin est éternel, c’est-à-dire anhistorique.
Comprendre pourquoi ce besoin n’a jamais été concrétisé, pourquoi la révolution n’a pas eu lieu, n’est donc jamais une affaire de rapports de force, lesquels ont de toute façon disparu avec les rapports sociaux. “Ce n’est pas la faiblesse des luttes qui explique l’évanouissement de toute perspective révolutionnaire, c’est l’absence de perspective révolutionnaire crédible qui explique la faiblesse des luttes.” La seule limite identifiée des luttes est la mauvaise conception de la révolution qu’elles se font. “Si les révolutions sont systématiquement trahies, peut-être est-ce l’œuvre de la fatalité, mais peut-être est-ce le signe qu’il y a dans notre idée de la révolution quelques vices cachés qui la condamnent à un tel destin.” Il faut donc déceler les restes d’illusion qui subsistent en nous et les éradiquer. Dans le texte, qui veut précisément substituer à une conception fautive de la révolution une conception supérieure, ce geste est celui d’une rupture définitive avec “ce qu’il reste de gauche” en nous, et de ses valeurs qui incarnent selon eux les valeurs d’une civilisation déjà morte.
LE NOUS COMME SEULE POSITIVITÉ
Elle est retrouvée. Quoi ? — L’Éternité.
C’est la mer allée
Avec le soleil.
Un sujet tout-puissant
Ce premier geste ouvre donc la voie aux révolutionnaires, en leur montrant l’opportunité d’agir face à un adversaire dont la puissance n’est plus qu’imaginaire. Si l’ennemi existe plus “dans les têtes” que dans le réel, ce n’est que la volonté d’agir pour l’abattre qui nous fait défaut. Un devoir-être révolutionnaire est alors substitué à la servitude volontaire des masses, ce devoir-être peut maintenant se déployer librement, et se donner les moyens de son existence, sans plus prendre en compte des rapports de force dévoilés comme inexistants. La figure du révolutionnaire, sujet du livre dont elle est également l’auteur, apparaît donc comme la solution au problème qu’elle s’est posé à elle-même dans ses propres termes. Le texte apparaît ainsi comme une entreprise solipsiste, où rien ne freine la volonté de puissance d’un sujet libéré de toutes déterminations concrètes. L’Etat n’existe pas, ni le capitalisme, et ni l’un ni l’autre ne pourront véritablement empêcher la constitution de ce sujet qui s’affirme comme tout-puissant.
Le ton optimiste et volontariste du texte est la manifestation de cette ivresse du moi qui saisit le sujet qui se sait au centre d’un univers dont la cohérence ne doit rien aux hasards de la conjoncture ou aux accidents de l’histoire, puisqu’il l’établit lui-même. Le “discours sur le peu de réalité” que constitue le livre nous donne l’image d’un monde qui n’existe que comme l’envers du moi, envers qu’il convient de renverser afin de rétablir l’unité, la coïncidence du moi et du monde. Les caractéristiques principales de ce sujet sont : son incorruptibilité, qui réside dans son fond subjectif. Sa subjectivité profonde, celle qui n’est pas corrompue par le monde, ne peut être que pure. C’est à dire que le sujet est toujours déjà “révolutionnaire” et cette aspiration ne demande qu’à être libérée. Etre révolutionnaire, c’est être du côté de la joie, du côté du lien avec les choses et avec les autres. Le sujet est ensuite essentiellement libre, il lui suffit de le comprendre en dissipant l’illusion de ce monde. La liberté n’est pas à conquérir, elle est un des attributs du sujet, qu’il lui suffit d’assumer. Pour finir, son arme est sa volonté. Elle est sans limites, comme son désir. Elle est ce qui actualise cette liberté, en la faisant passer sans effort du champ subjectif à celui du monde réel.
Ce sujet se donne un projet à sa mesure. Au monde perdu par le mauvais sujet qui s’est égaré dans les écrans d’Internet et ceux des Iphone, répond le monde retrouvé des vrais rapports, de la vraie vie. Nous ne sommes pas au monde, déplorait déjà Rimbaud. Et c’est un peu le déchirement de l’enfance (“notre seule patrie”) qui doit être réparé par la conduite du projet révolutionnaire. Ce projet, c’est la création de communes, définies comme une certaine “qualité de lien et une façon d’être dans le monde” (201/202). Pour créer des communes, il suffit de les déclarer, de l’oser. Cela revient à “sortir le temps historique de ses gonds, faire brèche dans le continuum désespérant des soumissions, dans l’enchaînement sans raison des jours, dans la morne lutte de chacun pour sa survie. Déclarer la commune, c’est consentir à se lier.” (202).
“La commune répond aux besoins en vue d’anéantir en nous l’être de besoin. Son geste élémentaire est, là ou un manque est éprouvé, de se doter de moyens de le faire disparaître autant de fois qu’il peut se présenter” 216.
La rupture avec le marxisme amène ici d’étranges résurgences fouriéristes, comme si après l’échec de l’ancien mouvement ouvrier il fallait remonter encore dans le passé pour retrouver le phalanstère comme outil de substitution aux conseils ouvriers chers aux situationnistes. Mais, comme l’autogestion finit toujours par s’enliser dans les catégories de la production et de l’échange, tous les phalanstères qui n’ont pas simplement échoué ont fini en entreprises commerciales. Il est vrai que la maison Godin produit d’excellents poêles et que les nuits sont fraîches sur le plateau de Millevaches.
Mais la commune est moins un outil pratique d’émancipation que l’occasion pour le sujet révolutionnaire d’éprouver son être au monde, de se lier à ses semblables et de faire croître sa puissance et sa “joie”.
Identifier l’identité
C’est qu’on peut se demander si les objectifs révolutionnaires affichés du CI sont bien réels. Est-ce qu’un groupe révolutionnaire qui aurait véritablement pour intention de s’emparer des centrales nucléaires de l’Etat français l’annoncerait dans un livre, dès lors que la simple évocation dans un livre précédent de sabotage de voies ferrées a déjà donné lieu à des poursuites judiciaires et à des accusations de terrorisme ? De même, on voit mal comment l’Etat tolérerait la constitution effectives de communes ouvertement hostiles, et appelant à renverser tous les pouvoirs en place. C’est bien qu’il ne s’agit pas véritablement de cela. La sécession opérée par les communes sera évidement aussi invisible que le comité qui y appelle, et aussi imaginaire que le parti qui l’a précédé. La constitution d’une identité qui se reconnaîtrait autour d’un tel projet révolutionnaire, qui se reconnaîtrait dans “ce qu’il faudrait faire”, est bien plutôt le principal objectif du livre. La “position commune” qu’il s’agit d’établir n’est dès lors plus le moyen, mais la véritable fin du texte.
Quelle est la nature de cette identité ? La “position commune” que le texte prétend vouloir affirmer est en réalité une position tout à fait particulière, tant il est vrai que tout ce qui existe réellement à une spécificité. Cette position, c’est d’abord évidemment sa position politique propre, située précisément dans l’altermondialisme qui a vu le jour avec les contre-sommets de Seattle et de Gênes. C’est ce milieu politique particulier, qui va des squats aux black blocs en passant par les tentatives néo-rurales de toute une partie de la jeunesse de la classe moyenne, souvent diplômée mais qui ne trouve pas à s’intégrer socialement au niveau auquel elle pourrait prétendre. C’est, plus récemment, le milieu qui va occuper les ZAD à Notre-Dame-des-Landes ou qui milite parmi les activistes no-TAV au Val de Susa. C’est ce milieu qui, tout en étant une composante de la “gauche de la gauche” citoyenne (ATTAC, écologistes, NPA, etc.) à la remorque de laquelle il est souvent contraint de se placer, ne cesse de la dénoncer comme réformiste. Cette existence politique déterminée, le CI la passe volontairement sous silence, afin de lui ôter sa particularité et de lui donner un caractère général et universel.
A propos de la critique du pouvoir comme infrastructure, le CI fait justement porter la critique là précisément où il a son activité, à savoir dans des luttes écologiques où les infrastructures sont en cause comme NDDL ou Sivens. Il entend par là donner une justification théorico-stratégique aux luttes dans lesquelles il est embarqué de par son activité militante. Mais pour le CI comme pour tout le monde, les conditions de la lutte sont données, même si mener une lutte est une activité. Constituer une théorie du capital-infrastructure parce qu’on est engagé dans ce type de lutte, c’est produire une illusion d’optique théorique pour des raisons stratégique de valorisation de la lutte. Une démarche véritablement théorique serait plutôt de se demander pour quelles raisons les luttes autour des infrastructures, les luttes à résonance écologique qui prennent pour enjeu l’appropriation du territoire par l’Etat et le capital revêtent aujourd’hui une telle importance, et ce que ce fait révèle sur la nature des luttes actuelles.
C’est donc à ce milieu, à cette mouvance qu’il s’adresse. Le CI produit une offre politique sans date limite de validité, puisque parfaitement anhistorique, qui ne parle de stratégie qu’en éliminant tout obstacle concret à son procès imaginaire de montée en puissance. Jamais situé, son discours est suffisamment large pour que “tout le monde”, parmi cette mouvance et plus largement dans la “gauche de la gauche” puisse s’y reconnaître.
Mais ce “tout le monde” n’est pas n’importe qui, et derrière tout sujet politique effectif, il y a un sujet social déterminé. Ce sujet, c’est la frange supérieure de la classe moyenne, dont le texte porte toutes les caractéristiques, à commencer par celle de s’affirmer en dehors des rapports de classe. C’est cette classe, ou ces segments de classe qui, depuis les Trente glorieuses se considère, et est produite socialement, comme une norme sociale. La classe moyenne, c’est ce à quoi tout le monde devrait pouvoir prétendre, la normalité sociale. Cette classe a le monopole de la politique, de l’expression, c’est à elle qu’on s’adresse, elle est le produit de la lente exclusion des catégories populaires du champ politique depuis la fin du mouvement ouvrier et la faillite de ses instances représentatives. Tout cela lui permet de s’affirmer comme une classe “neutre”, non polarisée socialement.
Le malaise existentiel décrit dans le livre est celui de la classe moyenne, de tous ceux qui partagent avec les auteurs le dégoût pour leur “commune situation” : “l’égale réduction au rang d’entrepreneur de soi” (49). La vie misérable de la classe moyenne, c’est sa “défiance scrupuleuse”, son “scepticisme raffiné”, “la sexualisation éperdue” de ses rapports (conséquences de l’importance de l’aspect relationnel et de la séduction dans des professions où l’on manie principalement des abstractions), sa “distraction permanente” qui a pour conséquence “ ignorance de soi, donc peur de soi, donc peur de l’autre”. Le nihilisme (et la culture du “narcissisme” cf. C. Lash), la perte de sens dont “on” souffre, c’est la pathologie de l’employé surdiplômé, de la classe moyenne cultivée insatisfaite des emplois qu’on lui propose, mais vivant dans la peur du chômage. C’est cet avenir tout tracé que la jeunesse des contre-sommets et des ZAD refuse, et auquel le CI offre une alternative.
Tout est décrit comme si rien d’autre n’avait d’existence que ce point de vue particulier. Ce désastre existentiel-là considère, de loin, la catastrophe des bidonvilles et des ateliers où on travaille quinze heures pour un salaire de misère comme presque souhaitable, en tout cas comme plus intense, plus consistante. Ces gens-là, du moins, ont de vraies communautés et de vraies raisons d’exister… C’est ce qu’on peut lire en creux dans les considérations sur l’absence au monde de l’homme occidental, qui doit réapprendre à habiter ce qui est là, à être présent. Ce “contact vital” avec le monde est une idéalisation de la misère a peine déguisée. La faim est un vrai rapport au monde qui s’oppose à la futilité du consommateur qui achète un Big Mac ou un Starbuck quand l’envie lui prend. Les militants se portent à la rencontre des communautés indiennes insurgées (celles qui sont du côté de la “terre”) comme les salariés stressés s’offrent trois semaines de vacances dans un pays où la misère est exotique, pour se “ressourcer”.
Ce qui rend possible la tenue d’un tel discours et sa diffusion massive, c’est la défaite du mouvement ouvrier, qui n’est évoquée dans le livre que pour discréditer le marxisme et son entreprise “fallacieuse”. En ce qui concerne son rapport à la gauche, loin de “larguer les amarres” le texte reprend la plupart des thèmes centraux de l’ultragauche (qui va de la gauche communiste aux situationnistes). La question de l’autonomie des luttes, de l’auto gestion et de l’auto organisation, qui étaient avant tout des problèmes pratiques, reflet des luttes et de leurs limites, sont sortis de leur contexte par le CI, appliqués à une époque qui ne porte plus ces questions en elle. C’est pourquoi le CI et ses partisans n’aurons jamais comme impact que la création de communautés alternatives marginales, pour ceux qui ont déjà les moyens de se passer du salariat et dont le problème principal est la “perte de sens”. La commune n’est pas le communisme, elle est en-deçà.
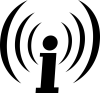

À nos amis...
....ist in der deutschen Übersetzung bei Nautilus veröffentlicht worden. Der Text wurde bei linksunten auch als pdf online gestellt. Eine Ergänzung (maintenant) erscheint bei lafabrique.
maintenant
Ist maintenant schon übersetzt worden? Oder gbt es den Text auf französisch vielleicht als als PDF?