C’est changer radicalement de partition que nous désirons. Inventer une musique qui soit faite d’autre chose que de l’organisation machinale, aveugle, déshumanisante de nos existences.
Notre révolte déferle, désormais. Notre désir de vivre, notre passion de vivre, notre énergie érotique, celle d’Eros comme pulsion de vie, réprimée durant des années, contenue dans une impuissance politique et une politique de l’impuissance, ne peut désormais plus être endiguée. On nous croyait mort, on nous voulait mort, nous voici debout. On voulait restreindre notre puissance d’agir aux mornes journées électorales de la République, voilà que nous l’occupons chaque nuit, comme place de la Commune, comme point de départ vers de multiples insurrections. Ce sont des milliers de vies qui se lèvent, chaque nuit, jusqu’au bout de la nuit, jusqu’au bout de toutes les nuits.
Nous sommes en train de vivre autre chose que nos survies misérables, de vivre, tout simplement. Nous sommes en train de construire, de nous construire, de nous auto-organiser, de nous insurger. Mais alors qu’un processus d’auto-organisation du quotidien des places semble pouvoir émerger, voilà qu’on nous propose encore de canaliser et de manipuler notre révolte de vivre au profit d’une politique « alternative » de l’impuissance, de transformer un torrent de vie en un canal administré « alternatif », de transformer une autonomie quotidienne des vivants en une machine électorale de conquête de l’administration des choses mortes, de l’économie. Notre pouvoir de vivre, de nous révolter et de nous auto-organiser quotidiennement, confisqué au profit d’une autre machine électorale qui, comme Syriza, ne pourra qu’administrer « alternativement » l’austérité capitaliste après confiscation des puissances d’agir d’un mouvement d’occupation de places. Et ce, au profit d’une « 6e République » soi-disant sociale, République qui n’a rien donné 5 fois sinon être érigée sur des cadavres, avec des Constitutions aux grands principes mystifiants, organisant une réalité étatico-capitaliste ; une politique « alternative » offrant au choix une sous-vie de 800 euros, un autre Syriza ou une URSS social-démocrate. Nous n’irons pas marcher sur des clous électoraux comme le fakir nous y invite.
Nos puissances de vivre et d’agir, veulent créer autre chose qu’une machine électorale, qu’un autre Syriza, qu’une autre République, qu’un autre RSA, qu’une autre URSS. Notre auto-organisation quotidienne, ses libérations de parole, ses joies, son effervescence, tout cela n’est pas destiné à une récupération politicienne n’ayant d’autre optique qu’une « autre » politique économique, qu’une autre misère, qu’une autre austérité, ou – au mieux – qu’un autre capitalisme. Les machines électorales s’emplissent toujours au fur et à mesure que nos places se désemplissent, en Espagne comme ailleurs. Notre autonomie est un début de quelque chose de grand, celui d’une vie collective libérée des misères et des servitudes économiques, libérée des soumissions politiques, libérée d’une organisation de nos vies par des puissances étrangères – l’économie et la politique.
Notre passion de vivre ne tient pas dans vos urnes ! Qu’est-ce que vous voulez que cela nous fasse votre politique, votre nécessité, vos pauvres histoires électorales et économiques ?
Misère de la politique
L’enfer de la politique et de l’économie n’existera plus dans l’avenir, d’ailleurs il n’a pas toujours existé. Les sociétés précapitalistes n’avaient ni « économie » ni « politique » au sens actuel puisqu’elles n’étaient pas des systèmes, des systèmes totalitaires, celui de l’État et sa Raison et celui du Marché et ses lois, et n’avaient donc pas de sous-systèmes « politiques » et « économiques » – quoiqu’elles obéissaient à des dominants et des religions. Il n’y a que lorsqu’un Marché unifié (unification douanière, commerciale, productive), hors-de-contrôle (avec ses crises systémiques, ses poussées impérialistes, ses modernisations forcées), totalitaire (avec son expansion mondiale et sa pénétration de l’ensemble de nos relations sociales, de nos activités, de nos subjectivités) émerge qu’advient l’économie comme sous-système des structures capitalistes de travail, de marchandise, d’argent et de valeur. De même, ce n’est que lorsqu’émerge parallèlement l’État (fin des seigneuries, des cités, des provinces) unifié (pouvoir centralisé, d’en haut), hors-de-contrôle (sa fameuse « raison d’État » et sa bureaucratie), totalitaire (pénétration de l’ensemble des relations sociales et définition de notre identité), que la politique fait son entrée fracassante dans l’histoire. La politique en tant que sous-système capitaliste naît en initiant une guerre européenne de 28 ans causant des millions de morts, en massacrant des milliers de sans-culottes radicaux – dont certains voulaient créer une société de communes – et de gens ordinaires, en établissant un Droit bourgeois, patriarcal, raciste, en lançant une industrialisation broyeuse de vies.
La forme structurée du système politique, l’aboutissement inéluctable de toute structure politique (même « démocratique »), c’est l’État, cette mégamachine centralisée, hiérarchique, bureaucratique, hétéronome, despotique, répressive. Puisqu’il doit se financer pour persévérer dans son être État, il a d’abord voulu (alors qu’il n’était qu’une monarchie) créer l’économie au moyen de réformes d’ampleurs (expropriations, concentrations foncières, libéralisation totale du commerce), pour financer une machine de guerre extrêmement coûteuse, et a accompli une partie des déstructurations nécessaires au développement de l’économie. Mais ce n’est qu’avec l’État moderne de 1789-1814 et ses bouleversements d’ampleur qu’émerge finalement l’économie et son corollaire, la politique, qui est d’abord politique économique et, réciproquement, économie politique, signe de leur alliance indéfectible.
Il n’y a pas de « politique », de système politique en-dehors de l’organisation du quotidien au sein des sociétés précapitalistes. Les sociétés gréco-romaines étaient politiques, au sens antique de structuration sociale autour d’une polis (cité), mais étaient complètement politiques, sans qu’il s’agisse d’un système séparé comme aujourd’hui. Les autres sociétés étaient étrangères à cette catégorie de « politique » puisqu’elles n’étaient pas fondées autour d’une polis (cité) et ne connaissaient pas de séparation entre « politique », « économie » et « religion », catégories spécifiquement modernes. La politique, au sens moderne, désigne essentiellement un des deux sous-systèmes du capitalisme¸ où elle est distincte mais tendanciellement subordonnée à son jumeau, l’économie. Le capitalisme est, ainsi, une totalité duale, avec des structures économiques (travail, valeur, marchandise, argent) d’un côté et des catégories nécessaires au fonctionnement et à une reproduction dynamique du capitalisme (droit, justice, police, armée, gouvernement) de l’autre.
La politique n’est pas qu’un gouvernement de l’économie, elle est également celui des homo oeconomicus, qu’elle réprime lorsqu’ils ne se contentent pas du cauchemar réalisé de l’économie et de l’État. Lorsqu’elle n’en impose plus par ses seules mystifications idéologiques, elle éradique. L’histoire de la politique, de l’État, comme celle du capitalisme, est écrite en lettres de sang et de feu, celles de la Terreur, des dictatures de modernisation forcées et des guerres napoléoniennes, des « semaines sanglantes » de 1848 et de 1871, des politiques d’industrialisation aussi destructrices qu’asservissantes, de l’élimination économique organisée des paysans et des artisans, de l’expansion coloniale-impériale génocidaire, quasi-esclavagiste, raciste, d’une guerre nationaliste intercapitaliste faisant des millions de morts, d’une transformation des ouvriers en robots du fordo-taylorisme, d’une politique pro-fasciste puis collaborationniste, d’une politique réformiste anti-révolutionnaire (désarmement des Partisans) en 1944-45, des guerres coloniales sanglantes, d’un pilotage d’une modernisation économique faite de travail usinier, d’industrie et de bombes nucléaires, de bétonnage, de Spectacle, de consumérisme et de répression de Mai 68, et enfin une politique de crise, néolibérale, répressive, dégradante, ses infâmes emplois de « services », son chômage technologique et ses mystifications idéologiques.
Pas d’économie, donc pas de politique, puisqu’elle est essentiellement politique économique en même temps qu’en complète dépendance financière vis-à-vis d’elle, puisqu’elle n’est qu’un garant de l’économie, ses contrats et ses propriétés, puisqu’elle n’est qu’un agent de fluidification, de gestion et de protection de l’économie avec ses infrastructures nationales, ses politiques macroéconomiques, son armée. Nous n’en voulons plus, de la politique comme bras armé de l’économie, comme autre face d’une même pièce capitaliste.
Crise de la politique, politique de crise
La politique est en crise, achevons-la ! La crise structurelle du capitalisme depuis 40 ans entraîne un recentrement de l’État vers ses fonctions de gouvernement de crise de l’économie en crise et de répression militaro-policière, dévoilant de nouveau son vrai visage, celui de ses origines, qu’il avait masqué au cours des soi-disantes Trente Glorieuses et auquel s’accroche désespérément l’altercapitalisme ambiant. Il n’y a plus de croissance, donc plus de droits sociaux, peut-il proclamer tranquillement. Le mensonge n’est pas celui, superficiel, qu’il n’y a plus d’argent, mais celui, fondamental, qu’il faut s’en remettre au dieu économie une fois de plus – et être offerts en sacrifice.
Dans une situation économique de crise, on voit l’État se délester progressivement de ses fonctions « sociales » pour se recentrer sur l’essentiel : relancer l’économie, et gérer ses conséquences socialement désastreuses au travers des activités de police et de gestion des masses inutiles pour l’économie. Réforme, réforme, réforme, c’est partout pareil, éternel retour du même et du pire. Il faut relancer la croissance, voilà l’idée fixe de ce monde où l’on marche sur la tête tout en se persuadant que c’est la seule façon de marcher. Mais quand l’air devient proprement irrespirable, que l’on se rend compte qu’on ne relancera jamais rien, alors c’est l’État sécuritaire, militaro-policier, répressif, cet État resserré autour de ses fonctions « minimales » de maintien de l’ordre capitaliste, qui s’impose, révélant ce qu’il a toujours été, un monstre froid, une monstrueuse organisation bureaucratique et militaire, un Léviathan. L’État-Providence, l’État « de droit » se démasque en État de punition divine des infidèles de l’économie, en État d’exception.
Nous sommes aujourd’hui dans une société de travail sans travail, dans une société de croissance sans croissance, et la crise qui en découle n’est pas une simple crise de l’économie, c’est une crise totale. Face à cette situation, si sortir de l’économie est une nécessité évidente, celle de sortir de la politique l’est moins pour beaucoup d’organisations ou d’intellectuels « de gauche » qui s’accrochent désespérément à cette vision mythifiée de la politique et de l’État, comprenant ceux-ci comme des faits transhistoriques, nécessaires aux sociétés humaines et, comble de l’ethnocentrisme, universels, alors même qu’il s’agit de structures spécifiquement capitalistes. Lutter contre le travail et son monde ne peut être une lutte pour prendre les rênes du pouvoir politique, ce ne peut être qu’une lutte antipolitique.
Une autre politique pour une autre économie, voilà l’éternel refrain toujours démenti de l’altercapitalisme. La politique alternative promettait autrefois d’attribuer une partie du gâteau grossissant de l’économie aux prolétaires, elle leur promet désormais un peu plus de miettes d’un gâteau décroissant. La politique « alternative » ne peut rien, n’y peut rien, elle dépend de l’économie, elle est au service de l’économie. Élisez un gouvernement altermondialiste, maoïste, citoyenniste, friotiste, anarchiste, trotskyste, stalinien, mélenchonniste, qu’importe, il n’y pourra rien. Sans sortir de l’économie, il faut obéir à ses lois et à sa crise. Sans sortir de la politique, il faut être un gouvernement de crise de l’économie en crise, c’est-à-dire un nouveau Syriza. Et l’échec de ces alter-gouvernements, s’il n’est pas sanctionné par une insurrection, débouchera sur un gouvernement technocratique ou une dictature militaro-nationaliste d’extrême-droite.
Syriza a choisi de ne pas trahir l’économie, sa raison d’être politique, de gouverner l’économie. Syriza, comme l’ensemble des partis altercapitalistes et/ou citoyennistes accédant au pouvoir, est l’arme secrète du capitalisme contre l’insurrection de ceux qui n’en peuvent plus, qui n’en veulent plus. Podemos, avec son programme social-démocrate de crise – « travaille » jusqu’à 65 ans, un RSA, un SMIC de 950 euros – qu’il ne réalisera même pas, est en phase de devenir un nouveau joker du capitalisme.
Le PCF avait choisi de ne pas trahir l’économie en 1968, il a donc choisi de trahir les insoumis. La CGT avait choisi de ne pas trahir l’économie en 1998, elle a donc choisi de trahir les révoltés. Il y aura d’autres trahisons, cette fois. Du citoyen-citoyenniste, peut-être ? Le citoyen, c’est l’esclave de l’État et de l’économie. Le citoyennisme est une cristallisation idéologique de cette servitude volontaire qu’il s’agit justement d’abolir.
Cessons de faire du salariat, du travail-marchandise, de la valeur, des marchandises, de l’argent, de l’entreprise, du Marché, du Parti et de l’État des « horizons indépassables » (alors qu’ils existent depuis quelques siècles au plus), des voies « émancipatrices » (alors qu’ils nous ont enchaîné depuis lors) et des institutions « révolutionnaires » (alors qu’ils brisent violemment nos révoltes). Voulons-nous vraiment, comme d’aucuns nous le proposent, retourner travailler pour 1500 euros dévalués mensuels dans les mêmes entreprises, pour produire encore les mêmes marchandises, le même argent et au final perpétuer ce même monde invivable ? Est-ce que nous désirons encore cette misère existentielle, être organisés, dominés, administrés par une bureaucratie d’État qui, comme n’importe quelle bureaucratie, finira corrompue, despotique, mortifère ? Pourquoi s’obstiner à vouloir tout changer pour que rien ne change ?
Nous ne voulons pas d’une République sociale-iste, ni d’un salariat universel, ni d’un capitalisme d’État, ni même d’une auto-exploitation gérée collectivement ; nous voulons une auto-organisation de nos vies et pour celles-ci, donc libérées de l’État et sa bureaucratie au profit d’une organisation autonome de notre monde. Une vie libérée de l’argent au profit d’une répartition de nos œuvres selon nos volontés et nos besoins, et des marchandises au profit de ce que nous voulons créer, faire, construire, et du travail au profit d’une vie s’épanouissant dans une diversité non-finie du faire.
Mettons ensemble nos puissances d’agir non au service de l’entreprise, libérale, étatique ou « auto-gérée », et leurs passions morbides, mais au service de notre désir de vivre lui-même.
Destitution de la politique
Auto-organisons nous, en-dehors des combines politiciennes et de leur misère érotique, pour construire ensemble une puissance d’agir collective grandissante, capable de s’accroître numériquement et en volonté de vivre, de s’attaquer aux puissances de répression et de domination politico-économiques et, une fois devenue forte, de vaincre éventuellement celles-ci et d’accomplir enfin cette volonté de vivre. L’accomplir en construisant une société de communes auto-organisées, comme en Aragon révolutionnaire en 1936, sans politique séparée, dominante, bureaucratique, sans économie despotique, injuste, mortifère, où nos puissances d’agir et nos passions de vivre s’épanouiront personnellement comme collectivement dans une multiplicité d’activités. Nous serons définitivement debout, ces nuits-là, et notre nuit durable, si brillante et si vivante, aura enfin mis fin au désert existentiel du capitalisme et son soleil de plomb étatique nous écrasant chaque jour.
La commune est en même temps une négation de la politique comme système séparé, hiérarchique, bureaucratique, autoritaire, et une réalisation de la politique, dissoute dans une auto-organisation quotidienne, horizontale, autonome. Auto-organisons nous, occupons tout, refusons d’être asservi-e-s aux machines électorales des « gauches alternatives » qui mériteraient aussi des droites avec leur misère érotique, et continuons ici comme ailleurs mais maintenant d’agrandir dans l’auto-organisation notre puissance d’agir. Ne refaisons pas « Mai 68 » : faisons mieux, beaucoup mieux.
Nous ne voulons abolir la politique que pour la réaliser. Nous voulons abolir celle-ci comme sphère séparée de la vie quotidienne, comme isoloir confirmant l’ordre capitaliste, et donc réaliser celle-ci dans la vie quotidienne sous forme de l’auto-organisation collective de nos vies. Les situationnistes ne voulaient pas abolir l’art, ils voulaient abolir celui-ci comme sphère séparée de la vie quotidienne, comme musée confirmant l’ordre capitaliste, et donc réaliser celui-ci dans la vie quotidienne sous forme d’une vie esthétique, d’une praxis épanouissante.
Se battre pour orchestrer la musique d’un monde en prenant une place depuis laquelle on ne pourra faire changer ni le rythme, ni la nature des sons, ni les instruments des musiciens ne nous intéresse plus. C’est changer radicalement de partition que nous désirons. Inventer une musique qui soit faite d’autre chose que de l’organisation machinale, aveugle, déshumanisante de nos existences.
Ce qui est à l’œuvre dans cette destitution continue et progressive de l’Etat, du capitalisme et de tout ce qui fait monde avec eux, au-delà d’une simple négation (comment ne pas nier vivement un monde qui nie la vie ?) c’est un non positif qui, en rejetant un certain monde, actualise en même temps une positivité auto-instituante de nouvelles pratiques et modes de subjectivation, d’où le « non » tire toute sa force. Un non qui affirme.
Il n’y a là aucun paradoxe. Notre puissance destituante, ainsi comprise, ne vise ni la ré-institution revue et corrigée d’une nouvelle version du pouvoir d’Etat, ni une simple dés-implication : elle ouvre un univers de possibilités, un univers de pratiques et de pensées. Notre destitution est puissance, elle n’est pas pouvoir. Puissance antipolitique, en ce qu’elle fait voler en éclats les frontières infranchissables qui séparent la vie du travail, la vie du loisir, la vie des décisions qui la concernent, sans se cristalliser dans des instances figées qui bientôt s’en séparent et s’autonomisent. Elle laisse surgir au sein de l’insurrection destituante un désir d’imaginer d’autres formes de cohésion sociales qui seraient en même temps d’autres formes d’activité, d’autre formes de circulation des biens, d’autres formes d’organisation collective, créant ainsi une nouvelle forme de synthèse sociale où travail, salaire, argent, temps de travail, consommation, production, élections, vote, parti, n’iront plus de soi.
Il nous faut persévérer dans la reproduction autre de nos vies jusqu’à ce que l’économie, fatiguée de nos auto-organisations et de nos désertions collectives, ne trouve plus de substrat sur lequel fleurir. Notre non doit être soutenu par une dynamique de création, par l’affirmation d’un autre-faire. Il doit s’ouvrir sur une diversité non-finie d’activités destinées à répondre de manière non capitaliste à la diversité de nos besoins. Il nous faut traduire en actes une conception non spécialisée, non séparée, non réifiée, non définitivement instituée mais toujours instituante et destituable de l’organisation collective de la vie et de l’activité.
L’autonomie est la forme d’anti-gouvernement qui permet à la fois le surgissement révolutionnaire anti-vertical et l’inscription horizontale d’une forme de vie commune qui dure, car elle combine un caractère négatif (se soustraire à l’imposition) et un caractère positif (affirmer ses propres règles). Il nous faut renoncer à une conception du politique fondée sur la puissance d’entités abstraites et unifiantes (l’État comme expression de l’universel) pour inventer des formes politiques partant de la capacité de faire et de créer de chacun, ancrées dans la multiplicité concrète des espaces et des moments. Et redonner au politique ses propriétés originaires : un temps, un lieu, des êtres, une vie qui se fait et se défait.
Notre destitution est donc pouvoir de et non pouvoir sur. Elle fait surgir au sein de notre moment insurrectionnel qui défait, qui brise le continuum historique de la temporalité capitaliste, un facteur instituant qui n’est pas une fin. Car notre antipolitique réside dans le dépassement de la distinction entre éthique et politique : abandonnons la distinction machiavélienne entre la fin et les moyens, celle-là même qui est reprise par Lénine dans sa conception du politique et de la révolution. Le monde que nous voulons créer brise la séparation instrumentale entre la fin et les moyens. Il n’y a aucune fin politique dans ce geste, aucune visée de ré-institution, d’une nouvelle distribution des organes d’exercice du pouvoir, même réformés, même démocratisés, même réappropriés, mêmes égalisés. Ce qu’institue le geste insurrectionnel, c’est l’ouverture d’une brèche.
Ne craignons ni le refus catégorique de ce monde, ni l’affirmation fiévreuse d’une vie autre.
Ne craignons ni de détruire, corps et âme, le monde qui nous détruit.
Ni de construire, cœurs et âme, celui que nous ferons fleurir.
Comité érotique révolutionnaire
https://lundi.am/L-AUTONOMIE-OU-RIEN
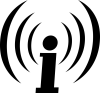
Bonustrack
Als pdf
http://data.over-blog-kiwi.com/1/48/88/48/20160418/ob_2c50b5_l-autonomie...
Als wunderschönes Audio
http://leslecturesdelecolo-libertaire.bandcamp.com/album/lautonomie-ou-rien